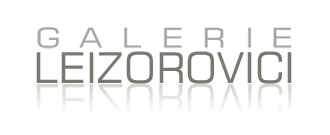Jacques GRANJEAN
Séquence « MARIE » 2001-2008
EN-DEÇA
Dans la séquence intitulée « Marie », le trait de crayon qui cerne les dépôts blanchâtres
désigne aussi bien les vides que les pleins, la surface de la feuille restée vierge que la surface
marquée d’un coup de pinceau. Ce trait gris est également à la charnière de la face visible du
blanc qui retient le regard, et de la face invisible qui adhère au papier. Il tente de cerner un
mystère. Il désigne l’endroit où commence l’envers.
Ce tracé gris a donc ici une double fonction :
1. Il articule trois espaces :
la face visible du dépôt de peinture (dessus),
la face invisible du dépôt (qui adhère au papier – dessous –),
l’espace vide la feuille entre les différents dépôts (autour).
2. Il reproduit graphiquement un acte pictural qui a eu lieu, comme un pli postal, toujours,
nous parvient d’un passé proche.
Le dessin, souvent, précède le travail de la couleur – c’est un croquis, une esquisse, une mise
en place – tandis qu’ici le trait de crayon succède à l’organisation des marques blanches sur
la feuille.
Réalisé APRÈS que j’aie disposé et composé les petites taches blanchâtres, ce trait vient dire
comme un cliché photographique, le souvenir d’une action.
Je dessine ce qui disparaît à mes yeux – plans qui se détournent, s’inclinent, s’enroulent, se
dérobent –. La graphie prend le relais aux confins de la forme. Un monde de matière sans
couleur et sans sujet commence à la ligne d’horizon, vers l’au-delà.
AU-DELÀ
Page fantôme, comme on nomme la feuille blanche glissée dans un registre, un dossier, pour
indiquer l’emplacement d’une feuille bien imprimée, celle-là, qu’on a momentanément
retirée à des fins d’étude, de photocopie, ou pour toute autre raison. Retirée. Éloignée.
Feuille disparue de son dossier d’origine, femme enlevée de sa couche pour être ensevelie –
Marie –.
Dans d’autres cultures que les nôtres, c’est le blanc qui est de rigueur pour le deuil. Ici, c’est
en noir, décolorisés, qu’autour de sa tombe se rassemblent ses proches ainsi cachés. Cette
absence de couleur pour dissimuler à la défunte, au ciel déjà sans doute, la colère qu’ils
éprouvent contre elle, parce qu’elle vient de leur retirer brutalement l’amour qu’elle leur
portait ou la protection qu’elle leur offrait.
Douleur certainement ; mais pour moi, très jeune enfant à ce moment, double colère, car
éprouvée également à l’endroit de mes parents, négligents, qui crurent devoir me cacher la
mort ; et pour cela, m’éloignèrent également des funérailles.
Trop petit pour riposter, trop tard pour pleurer, mais savais-je qu’on avait le droit de
pleurer ? Humiliation, vexation, camouflet longtemps camouflé. Blancs, donc, à des fins de
neutralité, d’invisibilité, de camouflage – du sucre répandu sur la neige –, qui apparaîtra au
printemps, si les deux ne fondent pas, ou qu’un œil attentif saura voir, et qui indique que le
deuil est vivant.
Blancs pas tout à fait blancs, teintes de la couleur des os, feuille ivoire ou légèrement rose
parcourue de traces de pinceau, irisées, décolorisées, muettes – voix blanche –, cernées d’un
trait de crayon – comme une ombre au tableau –, réminiscences quasi tactiles, pour se
rappeler un devoir de peinture, un besoin d’écriture. Blancs imparfaits, jaunis, moirés,
comme il y a des blancs présents, des blancs passés, des blancs futurs. Un temps, d’ordre
privé, qui régresse et progresse d’un même mouvement, dans une colère qui s’exprime enfin
et me revient.
AUTOUR
Puis-je, avec la présentation de ces éléments, réaliser un programme qui me permettrait de
prolonger ce travail ? Je ne le sais pas. En effet, ce sont ces propos, – compte-rendu de la
séquence -, qui me permettent aujourd’hui cette grille de lecture subjective.
Je n’ai pas cherché à articuler comme je l’ai écrit ici une topologie du vide avec le monde
sensible. Je n’ai réalisé les premiers travaux de cette séquence (qui comporte à ce jour une
soixantaine de planches) qu’après avoir pris longtemps pour choisir les papiers, mais tout
était décidé.
C’est ensuite que j’ai compris mon intérêt pour le blanc.
J’avais déjà rencontré divers blancs – chez Maurice Denis, sans enthousiasme, puis, plus
tard, avec intérêt, chez Serge Charchoune, Opalka, Absalon et Rachel Whiteread, si bien
nommée, ainsi que dans les « Drive-in » de Sugimoto, parfaits dans leur démonstration.
L’intérêt du blanc m’est apparu avec l’idée d’un geste dont la trace se perdrait dans la
feuille, ou dans l’imaginaire auquel elle renvoie : une virtualité laiteuse aux dimensions
indéfinies.
D’autre part, un grand choix de papiers blancs est disponible dans le commerce. Enfin, sa
large utilisation lui confère un statut de plus grande neutralité que toute autre couleur. Ces
raisons furent-elles suggérées ou soutenues par l’inconscient ? Je vous laisse imaginer :
commémoration, expiation, résilience, actualisation d’un temps révolu par l’exhibition des
obsèques de la peinture, non dans leur dimension historique, mais dans l’intimité que j’ai pu
avoir avec elle ? Peindre sans bien voir, dépeindre la peinture, créer une fantasmagorie, un
lieu où le passé se présente ?
Passé déploré, et non passé regretté, où je peux donner un sens à ce qui en fut privé ; une
époque lointaine où une souffrance avait été escamotée, dans laquelle avait été laissé un
blanc.
Paris, 2 décembre 2010

Aucune exposition liée à cet artiste.
Aucun livre lié à cet artiste.